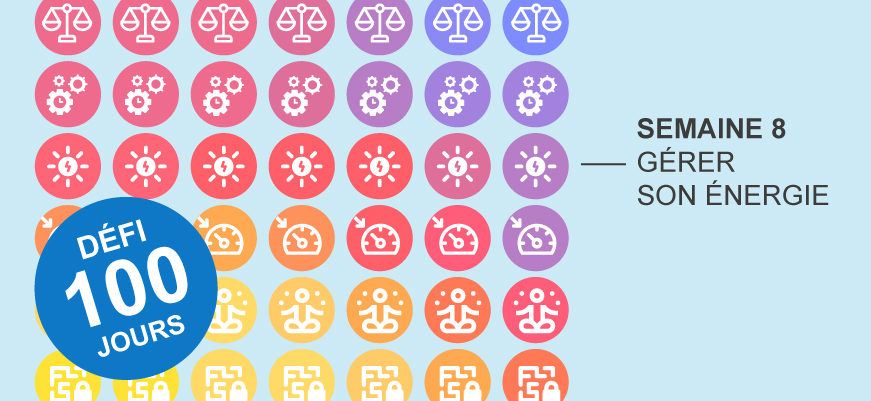Aujourd’hui, Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, de nombreuses personnes brandiront fièrement le drapeau aux couleurs de l’arc-en-ciel. Pour sa communauté et avant tout pour l’avenir de sa fille, notre collègue Marie-Eve prend la plume.
« T’es enceinte ? Félicitations. Ton chum doit être super content. »
Je fige. Mains moites. Je viens de comprendre. Comprendre que chaque félicitation s’accompagnera de mon coming out. Vertige. Cette phrase me ramène dix ans en arrière. L’acceptation est un travail de fond, ça l’air. Et là, je vais devoir sprinter.
J’ai toujours fait une scission entre ma vie personnelle et professionnelle. Vivre une grossesse en milieu de travail rend cette scission difficile, voire impossible. Cette fois-ci, les demi-vérités ont des conséquences.
Je dois assumer.
« Merci. Oui, ma blonde et moi, on est super contentes. »
Dans la majorité des cas, s’enchaîne une suite de petits malaises. Les gens sont surtout mal à l’aise d’avoir présumé que j’avais un chum.
J’ai probablement répété l’expérience une trentaine de fois.
Chacune de ces expériences est pénible.
Premier enfant oblige, chaque remarque est une première. Anxiété et gorge nouée.
Les cours prénataux semblent suivre la même logique. On s’inscrit un peu à reculons. Sur cinq, nous sommes le seul couple homoparental. Présentations faites, l’accompagnante à la naissance nous demande de scinder le groupe en deux. Les papas d’un côté et les mamans de l’autre.
Ma blonde et moi, on se regarde, incrédules. Elle ne sait pas où aller. Mon cœur se sert. Son rôle de mère doit-il être considéré comme celui du père pour le bien de l’exercice ? Je ne sais pas quoi faire. Je bous. Silence.
Ma blonde va avec les pères, l’estime dans les talons et des couteaux dans les yeux.
La dame nous assomme, sans aucune gêne, à coups de « votre chum », « votre conjoint » et autres synonymes hétéronormatifs. On se sent de trop. On est là, mais elle ne nous considère pas. J’étouffe.
Les microagressions jalonnent ma grossesse.
La bouffée d’air durant les premières semaines de vie de ma fille aura été de courte durée.
Cours d’aquaforme avec bébé. Je suis lessivée, K.O. Quatre jours sans dormir. J’attends d’entrer dans l’eau. La bonne humeur de ma fille illumine la pièce qui pue l’humidité.
Elle attire surtout l’attention du groupe de femmes qui nous cèdent le bassin. Ma fille est blonde aux yeux bleus. Je suis brune. On clashe.
« Oh, mon dieu, elle doit avoir les yeux de son père. »
C’est reparti. Mais ce matin, je n’ai pas l’énergie. J’ai envie de vomir.
« Non, elle a les yeux de sa mamie et de sa grand-mamie. »
Je courbe l’échine et je me prends le coup. Fatiguée. Je m’haïs.
Puis, les mois passent. Je travaille fort.
Aujourd’hui, cinq ans plus tard, je ne m’autorise plus jamais de demi-vérités devant ma fille. Parce qu’elle est fière d’avoir deux mamans. Moi aussi.
Je ne voudrais jamais le contraire. Jamais.
Même si parfois je fonds par en dedans. Que la gêne m’étouffe. Jamais.
Sans pour autant être une porte-parole pour la communauté LGBTQ2+, je me battrai pour que les formulaires à l’école soient inclusifs.
Je me battrai pour qu’elle ne se sente jamais comme sa mère s’est senti un certain soir de mai, quand on lui a demandé de troquer son rôle de mère pour celui de père.
Jamais.
À lire aussi :